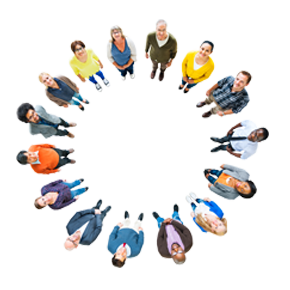Smart News Droit Social

Sophie Marinier
 Karine BézilleAssociéParis
Karine BézilleAssociéParisKarine Bézille
 Sandra HundsdörferAssociéParis
Sandra HundsdörferAssociéParisSandra Hundsdörfer

Smart News Droit Social
Nous vous proposons de retrouver régulièrement une sélection de l’actualité légale et jurisprudentielle en droit social.

ACTUALITÉ
Modification des formalités liées au détachement des travailleurs étrangers en France
Entrée en vigueur du décret sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
JURISPRUDENCE
Des mesures visant à prévenir des risques psychosociaux doivent être mises en place dans le cadre de l’élaboration du PSE
Un accord portant rupture conventionnelle collective ne peut remplacer un PSE lorsqu’il est conclu dans le contexte d’une cessation d’activité
Succession de CDD : l’employeur ne peut se fonder sur une faute commise au cours d’un précédent contrat
Licenciement pour inaptitude : obligation de reclassement d’un salarié inapte sur un poste en télétravail
Droit à la preuve : précisions sur la recevabilité d’un mode de preuve illicite
Revirement de jurisprudence : le salarié n’est pas tenu de qualifier les faits dénoncés de harcèlement moral pour bénéficier de la protection contre le licenciement
L’employeur doit préciser le motif économique dans les 15 jours suivant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle
L’action en paiement de la participation est soumise à la prescription biennale
Précisions sur les conséquences de la renonciation du délégué syndical
ACTUALITÉ
Modification des formalités liées au détachement des travailleurs étrangers en France
Le décret n°2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), entré en vigueur le 30 mars 2023, prévoit certaines mesures modifiant le contenu de la déclaration préalable de détachement (SIPSI) et de l’attestation de détachement ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail à tenir à la disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle.
Les informations à fournir pour la déclaration SIPSI sont allégées : l’employeur n’a plus à préciser la date de signature du contrat de travail, les horaires de travail et temps de repos, la nature du matériel et procédés de travail pour chaque salarié ainsi que les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, nourriture et d’hébergement.
En outre, l’employeur n’a plus à conserver sur le lieu de travail les documents suivants :
- tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le co-contractant établi ou exerçant sur le territoire national ;
- tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national.
Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
Entrée en vigueur du décret sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
Crée par la loi « Marché du travail », l’article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire, est présumé démissionnaire.
Très attendu depuis l’introduction de cet article dans le Code du travail, le décret sur la mise en œuvre de cette « présomption de démission » a été publié au Journal officiel du 18 avril 2023.
L’article R. 1237-13 du Code du travail précise que cette mise en demeure peut se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge. L’employeur doit laisser un délai minimal de 15 jours au salarié pour justifier son absence et reprendre son poste, ce délai court à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
À l’expiration de ce délai, le salarié est présumé démissionnaire. Les règles législatives, conventionnelles et jurisprudentielles relatives à la démission doivent donc trouver à s’appliquer.
Le décret liste plusieurs motifs légitimes pouvant être invoqués par le salarié afin d’écarter la mise en œuvre de la présomption de démission :
- des raisons médicales,
- l’exercice du droit de retrait,
- l’exercice du droit de grève,
- le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation,
- ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Cette liste est indicative et non exhaustive.
Par ailleurs, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes pour contester l’application de la présomption de démission. Dans ce cas, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement et les juges disposeront d’un mois pour statuer au fond.
Dans un Questions-Réponses du 18 avril 2023, le Ministère du Travail apporte des précisions sur la mise en œuvre de cette nouvelle présomption de démission. Il précise notamment le contenu de la mise en demeure adressé au salarié, les règles entourant le préavis en cas de démission, la remise des documents de fin de contrat, et l’articulation avec les dispositions conventionnelles.
Il s’est rapidement posé la question de savoir si l’employeur conservait la faculté de recourir à la voie du licenciement pour abandon de poste. La réponse apportée par le Ministère du Travail est assez claire : « Si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. » (Q/R n°1 du 18 avril 2023 relatif à la présomption de démission).
Toutefois, cette précision suscite des interrogations puisque ce Q/R n’a aucune valeur juridique contraignante, et que les dispositions légales et réglementaires ne privent pas les employeurs de pouvoir recourir au licenciement pour faute s’ils le souhaitent.
A ce sujet, le Conseil d’Etat a été saisi le 27 avril d’un recours pour excès de pouvoir demandant l’annulation de la mention de la Q/R n°1 sur l’exclusion de la procédure licenciement disciplinaire.
S’il convient sans doute de privilégier aujourd’hui la voie de la présomption de démission dans le cas d’un abandon de poste, celle du licenciement n’est pas définitivement exclue.
En revanche, une autre précision ne soulève aucun doute : si l’employeur souhaite conserver le salarié dans ses effectifs, il est libre de ne pas mettre en demeure son salarié et donc de ne pas utiliser la présomption de démission.
Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
JURISPRUDENCE
Des mesures visant à prévenir des risques psychosociaux doivent être mises en place dans le cadre de l’élaboration du PSE
Dans deux arrêts du 21 mars 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation et les modalités de contrôle par l’autorité administrative des obligations de l’employeur en matière de prévention des risques psychosociaux lors de l’établissement d’un document unilatéral portant PSE.
Selon le Conseil d’Etat, l’autorité administrative doit, au moment de l’homologation du document unilatéral portant PSE, s’assurer que la procédure d’information et de consultation du CSE a été régulière et que l’employeur a adressé à ce dernier des éléments relatif à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs et le cas échéant, les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
L’autorité administrative doit également vérifier, lorsque la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs que les actions arrêtées par l’employeur pour remédier à ces risques correspondent à des mesures précises et concrètes.
Dans la première espèce, si la DREETS s’était assurée que les institutions représentatives du personnel avaient bien été informées et consultées sur les risques psychosociaux, elle n’avait pas vérifié que le document unilatéral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La DREETS n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de risques psychosociaux, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer.
Dans la seconde espèce, le PSE soumis à la DREETS ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise au motif que tous les emplois étaient supprimés et donc qu’aucun salarié n’avait vocation à rester dans l’entreprise. Le Conseil d’État a relevé que la suppression de tous les emplois était de nature à avoir des incidences sur la santé physique et mentale de ses salariés.
CE, 21 mars 2023, n°460660 et n°460924
Un accord portant rupture conventionnelle collective ne peut remplacer un PSE lorsqu’il est conclu dans le contexte d’une cessation d’activité
Le Conseil d’Etat a précisé qu’un accord portant RCC ne peut être validé par l’autorité administrative lorsqu’il est conclu dans le contexte d’une cessation d’activité de l’établissement ou de l’entreprise en cause conduisant de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté pour le dispositif d’une rupture conventionnelle fassent l’objet, à la fin de la période d’application de cet accord, d’un licenciement pour motif économique et, le cas échéant, d’un PSE.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’employeur d’élaborer, par voie d’accord ou par un document unilatéral, un PSE qui doit être homologué ou validé par l’autorité administrative. Un plan de départ volontaire peut être prévu dans le PSE.
Dans l’affaire traitée par le Conseil d’Etat, ce dernier a confirmé l’annulation de la décision de validation d’un accord portant RCC conclu pour les salariés d’un site dont la fermeture avait été décidée par la société avant la signature de l’accord portant RCC. Cette décision de fermeture ne permettait pas aux salariés d’espérer un maintien dans leur emploi à l’issue de la période d’application de l’accord portant RCC et c’est un PSE qui aurait dû être élaboré.
CE, 21 mars 2023, n°459626
Succession de CDD : l’employeur ne peut se fonder sur une faute commise au cours d’un précédent contrat
La Cour de cassation précise que dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée, l’employeur ne peut prononcer une sanction disciplinaire en se fondant sur des fautes commises par le salarié au cours d’un précédent contrat.
En l’occurrence, une salariée a été embauchée suivant trois contrats à durée déterminée se succédant sans interruption. Son employeur rompt de façon anticipée pour faute grave son dernier contrat et pour justifier la rupture, se fonde sur des fautes commises au cours de l’exécution du précédent contrat.
L’employeur faisait valoir qu’il n’avait eu une connaissance exacte, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’au cours de l’exécution du dernier contrat.
Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation, qui affirme que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat, peu importe la connaissance tardive des faits litigieux.
Cass. soc., 15 mars 2023, n°21-17.227
Licenciement pour inaptitude : obligation de reclassement d’un salarié inapte sur un poste en télétravail
De manière inédite, la Cour de cassation précise que pour exécuter loyalement son obligation de reclassement, l’employeur peut être tenu d’aménager un poste en télétravail lorsque celui-ci est préconisé par le médecin du travail.
Au cas d’espèce, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste de secrétaire médicale. L’avis d’inaptitude précisait qu’elle « pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel (2j/semaine) en télétravail à son domicile avec aménagement du poste approprié ».
L’employeur faisait valoir qu’il n’existait aucun poste en télétravail au sein de l’entreprise, et qu’une telle organisation n’était pas compatible avec l’activité de la salariée.
Ce à quoi la Cour de cassation, répond qu’il s’agissait d’un aménagement de poste qui pouvait se réaliser au moyen d’un avenant au contrat de travail, et que les missions accomplies par la salariée étaient susceptibles d’être réalisées en télétravail. Par conséquent, l’employeur qui s’oppose sans raisons légitimes à la mise en œuvre du télétravail pour aménager le poste d’un salarié inapte, n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement.
Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-15.472
Droit à la preuve : précisions sur la recevabilité d’un mode de preuve illicite
Dans une série d’arrêts du 8 mars 2023, la Cour de cassation a complété sa jurisprudence en matière de recevabilité d’une preuve illicite.
Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle il résulte des articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraine plus nécessairement son rejet des débats.
Les arrêts donnent ensuite plusieurs indications sur le rôle du juge. En présence d’une preuve illicite, ce dernier est tenu de suivre une méthode de raisonnement :
- il doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci ;
- il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ;
- il doit enfin apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
Par conséquent, les décisions de recevabilité des éléments de preuve invoqués par les parties ont vocation à varier selon les cas d’espèces. C’est ce qu’illustrent ces trois arrêts rendus le 8 mars 2023 par la Cour de cassation.
- La recevabilité d’une preuve illicite obtenue par vidéosurveillance
Dans cette première affaire, une salariée a été licenciée pour vol sur le fondement d’extraits de la bande de vidéosurveillance, qui ont confirmé les soupçons de vol qui résultaient d’un audit diligenté par l’employeur qui mettait en évidence des irrégularités concernant l’enregistrement et l’encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée.
La salariée n’avait été informée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance, ni de la base juridique qui le justifiait, et l’employeur n’avait pas sollicité l’autorisation préfectorale préalable exigée par les textes.
La Cour de cassation considère que la production de ces enregistrements n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, dès lors que celui-ci disposait d’un autre moyen de preuve qu’il n’avait pas versé aux débats, à savoir l’audit.
- La recevabilité d’une preuve illicite obtenue par un dispositif de badgeage
Dans une seconde affaire, un salarié engagé en qualité de rédacteur juridique a été licencié pour faute grave. Pour justifier cette faute, l’employeur a produit des éléments issus du système de badgeage mis en place à l’entrée du bâtiment.
La Cour d’appel a relevé que ce système de badgeage, qui recueille des données personnelles, avait pour seule finalité, déclarée auprès de la CNIL et présentée au CSE, de contrôler les accès aux locaux et aux parkings, de sorte que ce mode de preuve constituait un moyen de preuve illicite et irrecevable.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en affirmant qu’il appartenait à la Cour d’appel de vérifier si la preuve litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de la salariée n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.
Par conséquent, si les données qui démontrent la faute du salarié sont collectées par un dispositif de badgeage illicite, mais que leur production en justice présente un caractère indispensable, la preuve est recevable.
- La recevabilité d’une preuve illicite obtenue par un procès-verbal des services de police
Dans cette dernière affaire, un salarié avait été engagé en qualité de conducteur de bus auprès d’une compagnie de transport. Après avoir constaté la disparition de titres de transport dans l’un des bus qu’il conduisait, il a déposé plainte auprès des services de police. L’employeur a mis à la disposition des enquêteurs des bandes du système de vidéoprotection équipant les véhicules. A leur tour, les services de police ont remis à l’employeur un procès-verbal, établi à partir des enregistrements donnés, dans lequel il était indiqué que le salarié avait téléphoné et fumé au volant. Par suite, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
La Cour de cassation constate que la communication du procès-verbal était intervenue dans le cadre informel des relations qu’il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l’article R. 156 al 1, du Code de procédure pénale.
Ensuite, elle retient que l’employeur a agi en méconnaissance des dispositions de la charte de vidéoprotection en vigueur dans l’entreprise, d’une part en acceptant de remettre les images de vidéosurveillance à la police alors qu’aucune infraction ou perturbation afférente à la sécurité des personnes n’était en cause s’agissant d’un vol de titres de transport sans violences, et d’autre part, en utilisant les constats tirés par les services de police d’infractions au Code de la route pour prouver la faute du salarié, alors qu’aux termes de l’article 3-3 de la Charte l’employeur s’était engagé à ne pas recourir au système de vidéoprotection pour apporter la preuve d’une faute du salarié lors d’affaires disciplinaires internes.
Le procès-verbal litigieux avait été obtenu de manière illicite et était dès lors irrecevable.
Cass, soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802 ; n° 21-20.798 ; n° 20-21.848
Revirement de jurisprudence : le salarié n’est pas tenu de qualifier les faits dénoncés de harcèlement moral pour bénéficier de la protection contre le licenciement
La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence applicable depuis sa décision du 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n°15-23.045) en considérant que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de sa dénonciation.
En l’occurrence, une salariée avait dénoncé par lettre le comportement de son supérieur hiérarchique ayant entrainé, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. La salariée a alors fait l’objet d’un licenciement pour faute grave au motif qu’elle avait gravement mis en cause l’attitude et les décisions prises par la direction. Elle a donc saisi les juridictions afin de faire juger la nullité de son licenciement motivé par la dénonciation de harcèlement moral.
L’employeur soutenait que le juge ne peut prononcer la nullité du licenciement qu’à la condition que le salarié ait qualifié les agissements dénoncés de harcèlement moral, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Toutefois, cet argument n’a pas été suivi par la Haute Cour qui a décidé de faire évoluer sa jurisprudence en la matière, au regard de sa position selon laquelle (i) l’employeur peut invoquer devant le juge la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sans qu’il soit tenu d’en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 16 décembre 2020, n°18-26.696) et (ii) le licenciement d’un salarié pour un motif lié à l’exercice non abusif de sa liberté d’expression est nul (Cass. soc., 16 février 2022, n°19-17.871).
La Cour de cassation juge désormais que les juges du fond doivent analyser si, au regard des faits dénoncés par le salarié, l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que celui-ci dénonçait des faits de harcèlement moral, peu important qu’il ne les ait pas qualifiés ainsi.
Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053
L’employeur doit préciser le motif économique dans les 15 jours suivant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle
La Cour de cassation se positionne pour la première fois sur l’articulation de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle selon laquelle la rupture du contrat résultant de l’acceptation du salarié au CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et les articles L. 1235-2-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail qui prévoient que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à suivant la notification du licenciement pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Dans cette affaire, deux salariées dont le contrat de travail a été rompu à la suite de leur adhésion au CSP le 27 septembre 2018, à l’issue de la procédure de licenciement pour motif économique qui s’est tenue le 21 septembre 2018 (entretien préalable, remise du document d’information sur le CSP et courrier précisant les difficultés économiques) ont saisi les juridictions en réclamation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elles soutenaient que l’employeur qui avait précisé le motif économique par courrier du 9 octobre 2018, n’avait pas respecté le délai de 15 jours pour préciser les motifs de la rupture, qui courait selon elle, à compter de la date de remise du document d’information sur le CSP, soit le 21 septembre 2018.
Or, la Haute Cour ne va pas suivre le raisonnement des salariées et va juger que le point de départ du délai de 15 jours est fixé à la date d’adhésion au CSP et non pas à la date de remise de la documentation relative au CSP. En conséquence, la procédure a parfaitement été respectée par l’employeur qui avait bien précisé les motifs du licenciement dans le délai de 15 jours suivant l’acceptation du CSP par les salariés.
Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-18.636
L’action en paiement de la participation est soumise à la prescription biennale
A la suite d’une QPC, la Cour de cassation avait jugé que l’action en paiement de la participation ne relève pas de la prescription triennale sans préciser quelle prescription était alors applicable (Cass. soc., QPC 23 mars 2022, n°21-22.455).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce clairement sur la prescription applicable en matière de créance de participation.
En l’espèce, une salariée qui avait rompu son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle en juillet 2017 sollicitait devant les juridictions en septembre 2019, le paiement d’une somme au titre de la participation des salariés pour l’exercice 2004-2005.
La salariée avait été déboutée par la Cour d’appel qui, dans une décision rendue avant l’arrêt de la Cour de cassation faisant suite à la QPC susvisée, a jugé l’action prescrite en considérant que la prescription triennale était applicable.
La Haute Cour a censuré la Cour d’appel en poursuivant son analyse initiée en 2022 et en jugeant que la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats laquelle n’a pas de nature de salaire, relève de l’exécution du contrat de travail. La prescription biennale est donc applicable.
Cass. soc., 13 avril 2023, n°21-22.455
Précisions sur les conséquences de la renonciation du délégué syndical
Par deux arrêts datés du même jour, la Cour de cassation apporte des précisions sur les conséquences de la renonciation du délégué syndical.
- Une organisation syndicale avait désigné en qualité de délégué syndicale régionale une salariée qui avait obtenu plus de 10 % des voix et avait été élue. Celle-ci avait ensuite renoncé par écrit à ce mandat, ce qui avait permis la désignation, par le syndicat, d’une autre déléguée syndicale régionale pour la remplacer. Quelques mois plus tard, l’organisation syndicale a de nouveau désigné la première salariée comme déléguée syndicale régionale.
La Haute Cour juge que la renonciation au mandat de délégué syndical n’est pas définitive, le salarié peut revenir sur sa renonciation au cours du même cycle électoral.
- Lors des dernières élections professionnelles une organisation syndicale a présenté 4 candidats (2 candidats ont ensuite quitté l’entreprise ; la 3ème a démissionné de son mandat de délégué syndical, et a renoncé par écrit à son droit d’être désigné comme DS le 5 août ; le 4ème n’est pas à jour de ses cotisations syndicales).
Le 6 août 2020, l’organisation syndicale a désigné un adhérent et non pas le 4ème candidat comme délégué syndical. L’employeur conteste alors cette désignation au motif que le syndicat ne démontrait pas la renonciation à sa désignation du 4ème candidat et que le paiement des cotisations syndicales n’est pas une condition légale à retenir pour exonérer le syndicat de cette renonciation.
Le tribunal judiciaire suit l’employeur et annule la désignation, considérant qu’un des quatre candidats initiaux pouvait prétendre à être désigné.
L’organisation syndicale forme un pourvoi. La Haute Cour casse la décision contestée en jugeant que le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l’un de ses adhérents conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 2 du code du travail, le tribunal aurait dû rechercher si le 4ème candidat avait renoncé à l’activité syndicale, cette renonciation pouvant résulter de l’absence de cotisations depuis plus deux ans est valable.